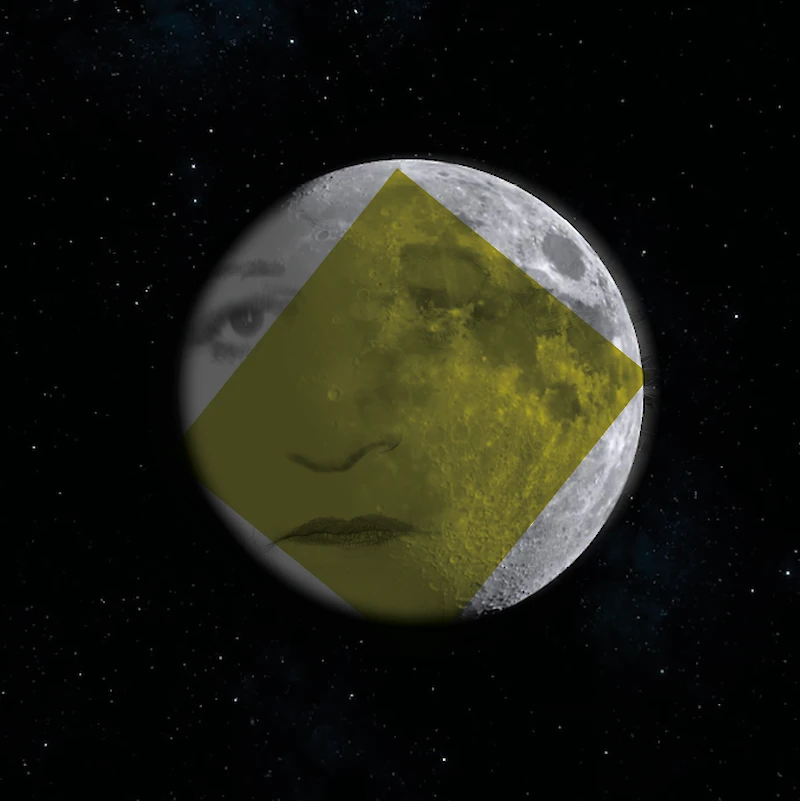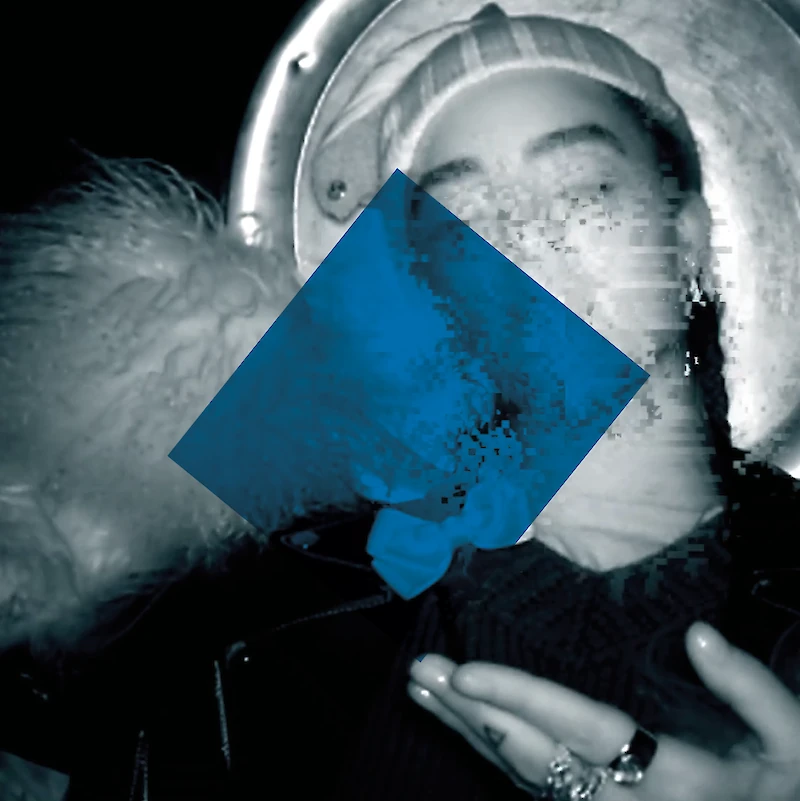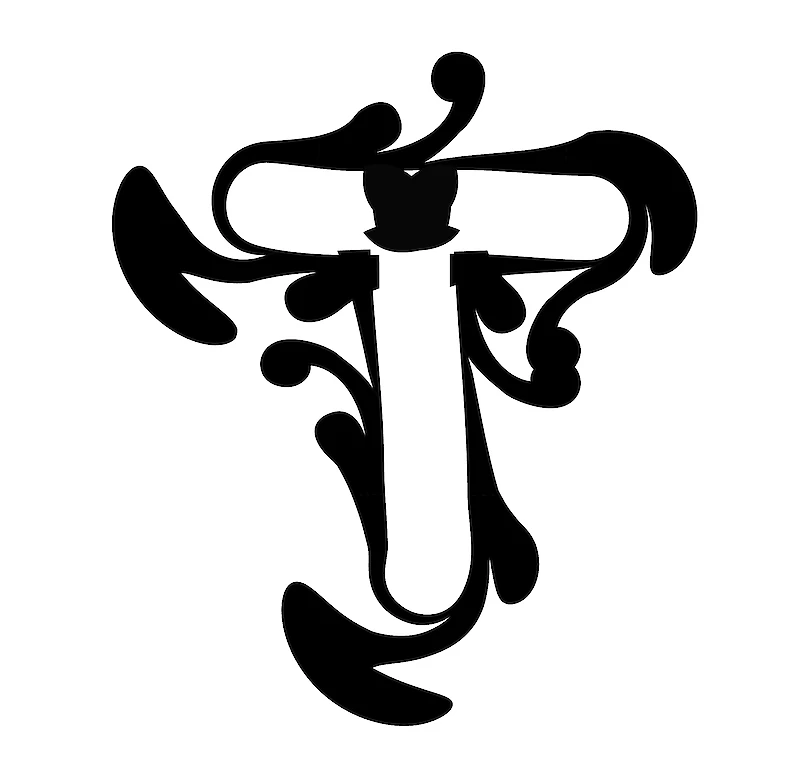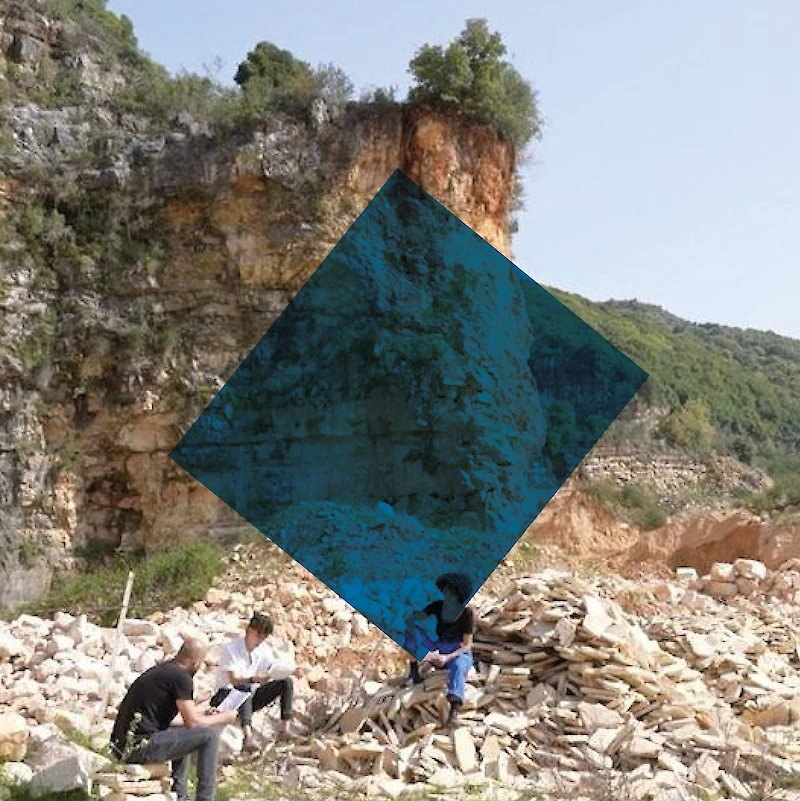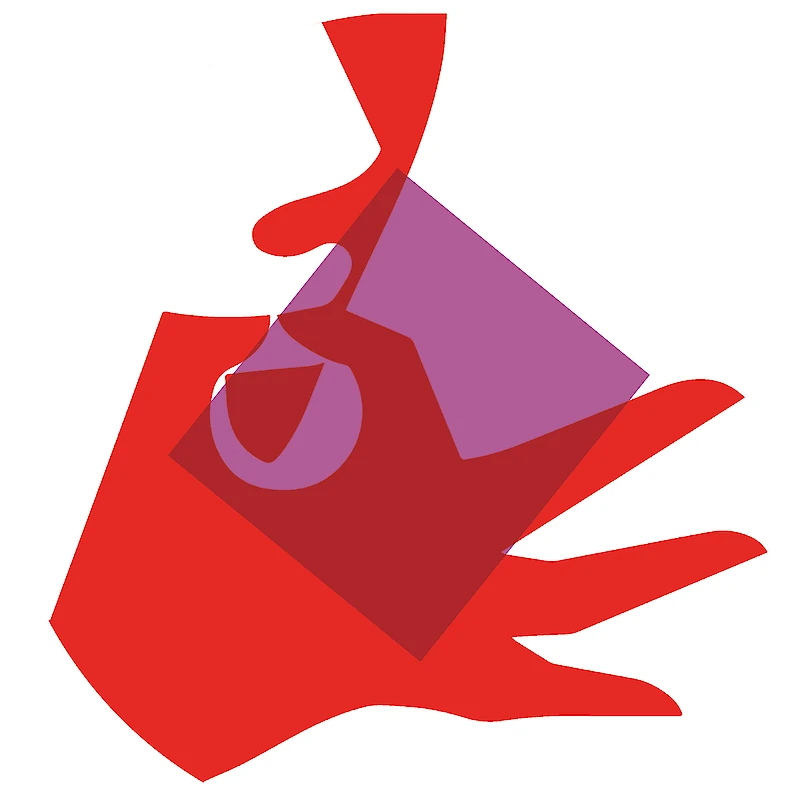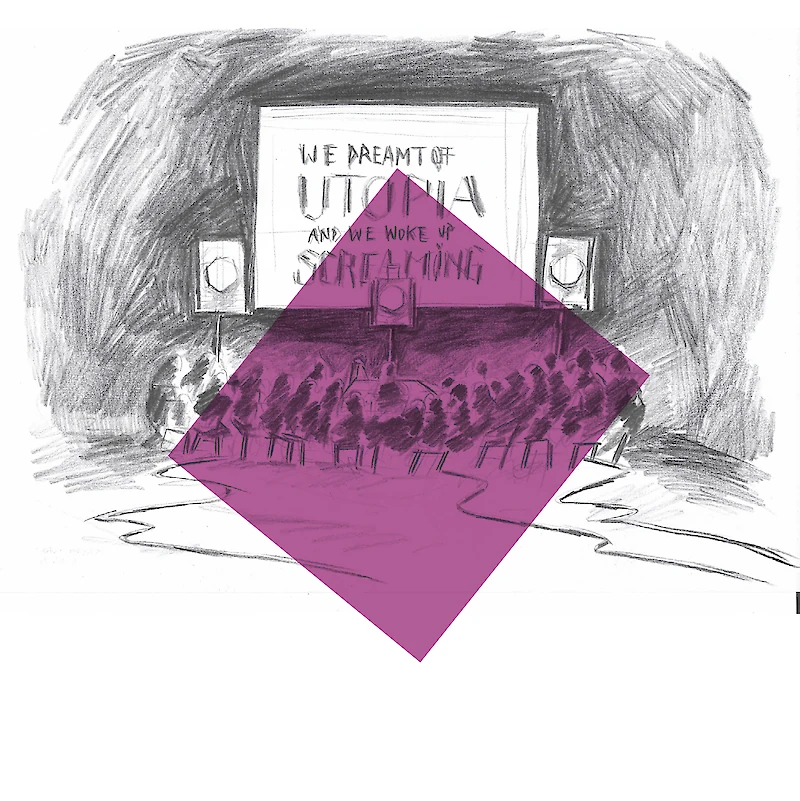"Je connaissais le racisme, je connaissais l’homophobie, l’islamophobie, avant la publication de mon livre, mais je ne savais pas encore ce que ça pouvait générer de s’exprimer librement, d’oser parler avec le coeur publiquement de ces sujets-là."
Fatima Daas donnait le coup d'envoi de la deuxième édition du festival Tashweesh avec une conférence sur son vécu de jeune écrivaine immigrée, musulmane et queer en France.
Bonjour à tout.es,
Avant de commencer je voudrais remercier toutes les personnes qui travaillent dur pour faire exister ce festival.
Merci de m’y avoir conviée.
Je suis honorée d’avoir la lourde responsabilité de faire l’ouverture de ce festival. Festival comme on les aime : féministe, engagé.
Il est très important d’avoir des moments pour réfléchir ensemble, discuter de nos histoires, comprendre et partager nos expériences par l’écriture, par la parole. Je crois que c’est urgent, au sein même de « nos milieux » d’ouvrir l’écoute, commencer à construire une analyse politique collective, renouer avec l’envie de lutter ensemble.
Donc voilà, comme vous l’avez compris, je suis très heureuse d’être ici, avec vous ce soir.
Je m’appelle Fatima Daas. Je suis autrice.
Je suis née à Saint-germain-en-laye, dans les Yvelines, à l’ouest de Paris, une ville riche de France. Pour vous situer un tout petit peu mieux, une commune près de Versailles.
On y a vécu pendant six ans avec mes parents et mes soeurs. On n’était pas chez nous, on vivait chez ma tante, la soeur de mon père et ses trois garçons.
Au cours de l'année 2000 (je me souviens que c’était en plein milieu de mon année scolaire de CP), avec ma famille, on a emménagé dans le 93, en Seine-Saint-Denis, en banlieue, à Clichy-sous-bois. Clichy-sous-bois, est l’une des villes les plus jeunes, une des villes les plus pauvres de France, une des villes les plus enclavées de la petite couronne Parisienne, c’est à Clichy-sous-bois, qu’ont débuté les révoltes urbaines de 2005 suite à la mort de Zyed Benna et Bouna Traoré. Deux adolescents de 15 et 17 ans, poursuivi par la police jusqu’au transformateur EDF, où ils ont été électrocutés, avec la peur au ventre. La peur de la police. La peur des coups de la police. La peur de l’humiliation. La peur de la mort.
À Clichy-sous-bois, j’ai vu des gamins de dix ans se faire fouiller, se faire contrôler, insulter. J’ai vu passer des médias nous poser les mêmes questions, attendant les mêmes réponses, déformer nos récits, ramasser notre colère à coup de grand sourire.
J’ai vu ce qu’on appelle « des artistes » venir monter des projets sur notre dos, dans notre ville voler nos images, voler nos histoires.
Parfois je me demande qui j'aurais été si on était resté à St germain en laye.
Je me demande si j’aurais écrit?
Et si j’avais écrit, mon livre aurait-il eu la même réception que celle que j’ai expérimentée en 2020 en France?
Bon reprenons, l’année du déménagement à CSB, j’ai failli redoubler la classe de CP, je suis passée de « justesse ».
J’ai redoublé l’année suivante, le CE1.
Il y avait souvent écrit sur mes copies en rouge « insuffisant » « à revoir », « il faut vous ressaisir » Je n’ai jamais eu de A ou de B.
J’étais toujours entre le C et le D. En cours d’acquisition ou non acquis.
Entre le 0 et le 4 sur 10. Le 0 et le 8 sur 20.
À l’école élémentaire, je me sentais en dessous des autres, je ne sais pas si c’est parce qu’il y en avait qui s’habillaient mieux, (ceux qui habitaient en zones pavillonnaire ou dans les petites résidences) n’importe où mais pas dans les tours, pas dans les bâtiments, pas dans une cité. Je ne sais pas si c’est parce que je voyais qu’il y avait papa maman, le soir en rentrant chez eux, papa maman, pour les aider à faire leurs devoirs, papa maman qui n’avaient pas gardé trop de traumatismes de la guerre, de l’exil. Papa maman qui savaient lire et écrire.
Quand j'ai appris à lire, j’ai eu la même tâche que mes soeurs: lire les courriers à mon père. Ça allait de la facture d’électricité, aux amendes, aux relevés bancaires, aux rendez-vous médicaux. Un jour, il nous a demandé de réparer la télécommande, il avait sorti la notice, comme pour dire « avec ça vous allez réussir »
On n’a pas réussi à la réparer. On a eu le droit à la phrase qu’on entendait le plus « vous allez à l’école et vous ne savez pas le faire »
Il avait l’air vraiment étonné, à chaque fois.
On a fini par lui répondre qu’à l’école, on n'a pas de cours qui s’intitule : « comment réparer la télécommande de votre père. »
Il nous a dit lassé qu'il ne comprenait pas ce qu'ils nous apprennent à l’école. Mon père nous a beaucoup répété qu’il n’est pas allé à l’école.
On a toutes fait des études. BAC +5. minimum.
À l’école élémentaire, au lieu d’avoir de bonnes notes bien méritées, parce que j’avais travaillé, à la sueur de mon front, je trichais beaucoup. Et ça m’allait très bien.
Quand je ne trichais pas, je trouvais des ruses.
Il y avait les poésies à apprendre par coeur et à réciter devant la classe.
On devait tous avoir un cahier travaux pratiques, la page de gauche à carreaux, la page blanche à droite.
Sur la page de gauche on collait la poésie que la maîtresse nous distribuait, sur celle de droite, on devait illustrer la poésie.
C’est ma grande soeur qui me faisait mes dessins. Je n'ai jamais su dessiner, ne serait qu’un nuage, un soleil, une maison, un bonhomme. Rien.
À partir du collège, j’ai commencé à capter le truc.
J’en ai eu assez de me sentir en dessous, alors j’ai fini par me sentir au-dessus. C’est l’école qui m’a appris ça, qu’on pouvait passer du dessous au-dessus, en un rien de temps. On peut passer de la mauvaise élève à la bonne. À l’élève qui est meilleure que les autres. Au collège, je suis devenue la rebeue, intelligente, qui comprend vite et fini vite ce qu’on lui donne à faire, qui s’ennuie aussi, alors il faut bien l’occuper.
J’étais celle qui a du caractère, celle qui influence les autres dans le bon ou le mauvais sens, genre j’avais à la fois le pouvoir d’aider mes camarades à se dépasser et en même temps les entrainer à foutre la merde. Ça fait beaucoup !
Du coup j’étais tantôt celle qui réussit, et la sauvage de service qu’il faut ménager pour pas que ça pète.
Au collège, j’ai commencé à ressentir plus fortement la colère dûe aux injustices que j’observais, que j’expérimentais.
Pendant un moment cette colère s’est traduit par de la violence.
À treize ans j’ai écrit mes premiers textes.
Avant l’écriture, j’avais des choses plein la tête, des images, beaucoup de tristesse, de honte, de colère, mais pas de mots pour les exprimer, tout dans la tête et le coeur. Ça ne sortait pas, ça restait bien à l’intérieur, enfoui, l’air de rien.
À 13 ans, je suis entrée en écriture avec la mort de ma cousine de 4 ans.
Alors dans la tête, encore beaucoup de tristesse, mais surtout des questions et le besoin de tourner autour de cet épisode tragique, pas pour trouver une solution ou une réponse à la mort de ma cousine, ou la mort de manière générale.
J’ai écrit pour ne plus me taire, pour ne pas étouffer dans l’incompréhension. Écrire ce qui me paraît absurde, incompréhensible, flou, impossible.
« Comment peut-on mourir à 4ans? » Je me suis beaucoup répété cette phrase.
Ça n’allait pas dans l’ordre des choses, l’ordre de la vie, telle qu’on me l’avait expliqué ou telle que je l’avais compris à treize ans. Un enfant ne meurt pas.
Alors j’ai écrit.
J'ai écrit des lettres à cette cousine de 4 ans, je lui disais ma culpabilité d’être en vie, je lui racontais mes journées au collège, mon lien à l’écriture que je voyais grandir…
À partir de ce moment-là, je n’ai fait qu'écrire pour parler.
J’ai écrit à ma soeur quand je me suis fait virer la première fois du collège.
Je lui ai écrit à chaque connerie que j’ai faite.
J'ai écrit des lettres à mon père que je ne lui ai jamais donné, que je lui ai jamais lu, qu’il ne lira jamais.
Je n’ai pas cessé d’écrire, depuis mes treize ans.
Je suis autrice, et ça depuis que j’ai conscientisé mon lien à l’écriture.
Je n’ai pas attendu de publier des livres avant de me nommer écrivaine.
Je suis écrivaine depuis mon premier texte, depuis que j’ai eu besoin de le continuer et d’en créer d’autres. J’ai senti assez vite que l’écriture allait être mon endroit, mon chez-moi, mon abri, et surtout que personne n’arriverait à me retirer la liberté d’écrire.
Si je suis autrice, c'est parce que je suis en colère.
J’ai une colère stockée dans mon ventre, c’est une colère qui ressemble à une boule rouge qui grossit de jour en jour, que l’écriture empêche d’exploser.
Cette colère, je l’ai sentie pendant l’enfance, quand je cachais la langue de mes parents, ma langue, l’arabe algérien, parce que j’avais honte et peur en même temps, honte de ma langue, peur qu’on imagine que je ne parle pas bien le français, en France, parce que mes parents parlent arabe avec moi, à la maison. Parce que je suis enfant d’immigré.
J’ai senti cette boule rouge, quand je faisais comme tout le monde avant les vacances de Noël, à l’école élémentaire, quand je prenais ma feuille et mon stylo et que j’écrivais la liste de cadeaux au père Noël. J'y croyais pas du tout, alors je me forçais , par mimétisme, par peur sans doute de ne pas me sentir intégré en France.
C’était la consigne de la maitresse et tout le monde le faisait , alors moi aussi je l’ai fait. Au fond de moi le plus beau cadeau que je pouvais demander au père Noël ou à je-ne-sais-pas-qui c’était d’arrêter de mentir, d’arrêter de me sentir différente, d’avoir honte, parce que je ne fêtais pas Noël. Cesser d’avoir honte d'être pauvre, ne pas pouvoir donner de l’argent à la coopérative de la classe, galérer à trouver 2, 3 euros pour les sorties scolaires, qui arrivaient au minimum une fois par mois…
Cette colère je l'ai ressentie quand je devais taire ma fluidité de genre, parce que j'étais trop garçon pour l’Éducation nationale, je n'étais pas assez une fille pour ma famille, pas une fille assez docile pour les garçons, j’aimais trop les filles pour être une fille ,pas assez, pas assez, ou trop.
La colère, elle a toujours été là, dans une partie de mon corps, accrochée, dissimulée, parfois anesthésiée par l’amour, par la sororité, par la foi…
Elle a ressurgi au lycée.
Quand on m’a utilisé comme un trophée pour incarner la réussite en banlieue, devenir un exemple, le symbole de la méritocratie : celle qui réussit à l’école, parce que quand elle veut elle peut.
J’ai voulu prouver qu’à Clichy-sous-bois on peut réussir, je me suis laissée porter, amenée à faire une grande école alors que moi, je voulais juste écrire.
Et c’est déjà beaucoup .
Heureusement, il y avait ces moments volés, des ateliers d’écriture qui me réconfortaient, pendant lesquels j’ai pu écrire à plusieurs mains, partager mes textes, croire en mon écriture. Me rendre compte que la réussite c’est peut-être juste finir d’écrire une histoire, trouver sa voix, son style, rester intègre.
J’ai ressenti une colère immense après le lycée, quand j’ai compris que le monde n’était qu’une reproduction d’inégalités infinies, qu’on m’avait bercé d’illusions.
Combattre les inégalités, c’était forcément en générer d’autres.
Cette colère, elle s’est propagée un peu partout dans mon corps, pendant des années, parfois elle remonte de mon estomac à mon oesophage, jusqu’à ma gorge, elle reste là, bloquée parfois. Et je ne peux plus parler. Je ne peux plus rien ressentir à part cette colère qui me rend muette, et qui me glace le sang.
La colère s’est démultipliée quand je suis devenue officiellement écrivaine, autrice, personnage public, personnage médiatique….
Elle a grossi, grossi quand j’ai réalisé que je ne passais pas une journée sans recevoir une insulte raciste, sexiste, homophobe, ou les trois en même temps. De l'insulte directe à l’humour décomplexé.
Je connaissais le racisme, je connaissais l’homophobie, l’islamophobie, avant la publication de mon livre, mais je ne savais pas encore ce que ça pouvait générer de s’exprimer librement, d’oser parler avec le coeur publiquement de ces sujets-là.
Il y a deux ans mon livre « La petite dernière», est paru en France à la rentrée littéraire de 2020.
C’est un roman qui ne répond pas à une chronologie exacte. Le récit fonctionne par variation. Chaque chapitre témoigne d’une facette de l’histoire de la narratrice. Fatima, le personnage principal se dévoile par petites touches au rythme de phrases courtes, tendues, entrecoupée de silence comme lié à une respiration saccadée.
Chaque court chapitre vient accentuer le souffle court et l’urgence de dire de manière directe, le plus facilement, le plus rapidement possible ce qu’on a trop retenu.
Tout au long de mon projet d’écriture, j’ai tenté de trouver une voix, un langage qui fait place aux silences.
La petite dernière c’est un roman qui s’articule à la première personne, c’est l’histoire de Fatima Daas, personnage à l’intersection de plusieurs discriminations, c’est une jeune femme qui fête ses trente ans à la fin du roman, on la suit de son enfance à l’âge adulte, par bribes. On passe d’un souvenir à un autre, souvenir d’enfance, au collège, sa bande de copains, sa meilleure amie, Rokya sa confidente, son rapport à l’enclavement de la ville, les regards croisés dans les transports, l’écriture, la maladie: l’asthme, les amours, la famille, la religion.
C’est une explosion, un cri, une urgence, une nécessité, un cheminement pour parvenir à dire « je », « je suis » « je veux » « j’aime ».
Un personnage qui se heurte à l’impossibilité d’être, d’exister en France.
J’ai eu envie de parler de la difficulté de grandir sans représentation, sans visibilité seulement avec la haine et la honte de soi. La difficulté à faire un choix dans un monde qui nous uniformise, nous pousse à nous essentialiser, et qui n’est pas prêt à faire de la place.
Comment garder le silence le plus longtemps possible ? Comment garder un secret qu’on meurt d’envie de dévoiler à tout le monde mais que personne ne veut entendre. Peut-on réussir à dire ce secret sans le dire ?
Je n’ai pas pensé mon roman comme un discours qui prétendrait dire, mais j’ai essayé de restituer des sensations que les différents silences produisent au quotidien, sur moi, ce que ça de l'intérieur d’expérimenter de manière simultanée les injonctions en tous genres.
J’ai essayé de faire exister une histoire qui est souvent tue et presque jamais entendue. 7
Si je continue comme ça et que j’essaie de discuter avec vous maintenant de ce que j’ai ressenti depuis la sortie du roman , je dois vous parler de Faïza Guene.
18 ans séparent la publication de mon premier roman à la publication du premier roman de Faiza Guene, Kiffe kiffe demain, mais en France en dix-huit ans, on assiste au même processus, au même traitement ingrat des médias sur nos histoires, sur notre parole.
Pendant ces deux dernières années j’ai discuté avec de nombreux journalistes, j’ai découvert l’idée qu’ils avaient de mon livre, ce qu’ils y voyaient, ce qu’ils avaient compris.
Des chercheuses, lesbiennes, et/ou issue de l’immigration se sont mises à travailler sur les enjeux de la réception médiatique de La petite dernière, comme ça a été le cas pour l’autrice Faiza Guene, et d’autres parcours de femmes issues de l’immigration.
Il m’a fallu plusieurs mois, plusieurs rencontres pour poser les premiers mots sur ce qui est arrivé. Revenir à mon texte, revenir à la sensation que je recherchais face à mon écran d’ordinateur. Qu’est-ce-que j’avais voulu faire? dire?
Les questions des médias étaient à quelques exceptions près orientées sur l’Islam et l’homosexualité.
De manière générale, les questions qui revenaient le plus souvent c’était :
Comment conciliez-vous l’islam et l’homosexualité?
Quelle a été la réaction de votre famille?
Peut-on vraiment être lesbienne et musulmane?
Quelle a été la réaction des personnes vivant à Clichy-sous-bois ? Ou de la communauté musulmane?
Quel est votre rapport à l’Islam?
Votre texte ressemble à du rap, ou à des versets de coran?
Qui vous a amené à l’écriture?
« Ce récit à la première personne, est-il aussi un moyen de donner une voix aux jeunes musulmanes queer ? »
Votre livre a été écrit dans le cadre d’un master de création littéraire comment s’est passé le processus de création?
« Votre récit est ponctué de définitions, de traductions. À quel point le choix des mots est important pour vous ? Est-ce un reste de vos années de prépa ? »
Le livre montre aussi des relations familiales tendues avec un père algérien violent et inhabitué à toutes manifestations de tendresse et d’amour…
Quand il n’y a pas de questions. Il y a toujours les mêmes remarques, les mêmes intentions, certaines plus frontales, avec un racisme décomplexé, d’autres tournures de phrase plus sournoises.
De nombreux passages d’articles examinent mon parcours scolaire pour justifier la réussite de mon livre, mais je n’en citerai qu'un seul.
« Au lycée, encouragée par ses professeurs de français, elle participe à des ateliers d'écriture avec l'écrivain Tanguy Viel. C'est là qu'elle commence à écrire de la fiction. »
(Par ailleurs, j’écrivais de la fiction bien avant d’être au lycée. )
Il y a aussi le fantasme selon lesquels j’aurai abandonné Clichy-sous-bois comme pour me protéger des attaques que j’aurais pu recevoir par les racailles de ma ville.
« son bac en poche, elle quitte Clichy-sous-Bois pour faire une licence de Lettres à Paris avant d’intégrer le master de création littéraire de L’université Paris 8, à Saint-Denis. »
Depuis, le livre a bénéficié du "parrainage" de l'écrivaine Virginie Despentes, qu'elle avait rencontrée pendant son master. « La jeune écrivaine étrille la famille, sa mère trop femme au foyer, son père trop mâle attitude »
« Croyante et lesbienne : telle est la dissonance majeure avec laquelle la narratrice cherche à apprendre à vivre. »
« Croyante et lesbienne : d’une prose intrépide, l’autrice cherche comment vivre avec l’inconciliable. »
« Elle n'est pas en cure de désintoxication pourtant cette beurette de Clichy-sous-bois, fervente mais attirée par les filles livre des vérités inavouables. »
« Une banlieusarde entre deux cultures »
"L’adolescente va vite se constituer une double culture entre voyages « au bled », prêches familiaux et influence hip-hop de ses camarades. Au lycée, elle accepte difficilement son homosexualité et participe à des ateliers d’écriture conduits par l’écrivain Tanguy Viel « sans doute pour dépasser certains non-dits dans (sa) famille ».
« Un roman scandé comme du slam »
Elle s’appelle Fatima Daas, sa mère règne dans sa cuisine et son père manie la ceinture sur les reins de ses filles avec rudesse. »
Depuis deux ans, je me suis rarement senti autrice mais je me suis sentie redevable. La chance, j’avais de la chance.J’avais la chance de remplir le quota jeune autrice, parfois jeune autrice de banlieue, parfois jeune nord-africaine, parfois lesbienne et musulmane. J’étais devenue le support de polémiques, celle qu’on a envie de coincer , de déstabiliser, d’écraser, de faire taire. Nos histoires dérangent, elles ne peuvent pas être universelles, elles sont forcément communautaires.
J’étais redevable et ingrate. Je ne disais pas assez merci à la France.
Merci au pays des droits de l’homme, de me donner la parole, de m’autoriser à parler, merci de faire de moi la révélation de la rentrée littéraire quand bien même ils ne me considèrent pas comme une vraie française, et encore moins comme une autrice. Tout court.
Je suis en colère qu’on demande toujours aux mêmes, de ne jamais se plaindre. De taire cet épuisement. Mais la vérité c’est que ma parole n’est pas accueillie, elle est sectionnée, martelée par les regards racistes, normés, islamophobes. Et je le vois, et je le sais aujourd’hui et nous sommes nombreux-ses, à le savoir et à ne plus avoir peur et honte d’en parler.
Écrire ce roman et en parler me coute à chaque fois, mais ça je n’ai pas le droit de le dire. Alors je vais le dire.
L’école de la république ne m’a pas faite , elle ne m’a pas forgée. Aucun professeur ne m’a amenée à écrire, aucun professeur ne m’a donnée goût à l’écriture, aucun ne m’a sauvée. J’ai écrit parce que c’est ma seule arme pour lutter contre le silence qu’on m’impose.
Redevable, ingrate et porte-parole.
Assez vite, je suis devenue la porte parole des jeunes lesbiennes, issues de l’immigration, musulmanes, comme si mon histoire était la même que toutes les personnes nords-africaines queers, comme s’il n’existait pas plusieurs parcours, comme si nous étions qu’un, comme si nous étions les mêmes.
On nous confond entre nous, en festival, on se retrouve entre femmes issues de l’immigration, parce qu’on raconte la même chose pour eux, parce que pour eux on a les mêmes vies.
La colère est là. À chaque fois. À chaque prise de conscience. Et je suis fatiguée. Et on est fatiguées. Non on ne se victimise pas . On est épuisées éreintées et notre fatigue est la même.
J’étais devenue dans l’imaginaire universel la lesbienne homophobe.
Quand on est musulmane on est forcément homophobe quand bien même on est lesbienne. Quand on est Algérienne, on nous demande de remercier la France de nous avoir accueilli. Quand on est lesbienne, on doit être blanche et athée.
Quand on est banlieusarde, on doit avoir été sauvé par un.e prof blanc.
On ne peut jamais être ce qu'on est et être vu comme tel.
Il n’y a pas un jour sans lequel je suis ramené, à ma religion, à ma famille, à mon algérianité, à mon lesbianisme…
Ce qui pose problème, c’est que je suis arrivée avec ma tête d’arabe, mes cheveux coupés court, mon corps de garçon lesbienne, mon corps de banlieusarde, je n’ai pas remercié la France, ni l’école de la république et ses profs, ni aucun homme, ni aucune femme blanche qui m’aurait sauvé de ma condition de femme maghrébine, soumise au père, et à la religion islamique.
Je n’ai pas craché sur l’Islam, j’ai plutôt dit mon amour.
Je n’ai remercié personne, je suis arrivée avec ma dignité d’algérienne, ma fierté, ma fragilité, et surtout avec la volonté de rester intègre, de garder mon intégrité, de ne pas les laissez me récupérer, ne pas les laisser me faire dire ce que je ne veux pas dire, ni me mettre dans aucune case. Ne pas les laisser me réduire.
M’effacer.
Me rendre invisible.
Je n’ai pas envie de les laisser gagner.
Je vais continuer à écrire et à casser l’ambiance.
J’ai en moi ce besoin de revanche. Une revanche pour l’adolescente que j’étais, celle qui s’est tue, celle qui n’avait aucune représentation à laquelle s’accrocher…
Il me manquait cette histoire, je l'ai écrite.
J’ai envie de dire à cette Fatima adolescente que je l’aime, qu’elle n’a pas à avoir honte, qu’elle va tout niquer.
On est nombreux/ses à tout niquer!
Alors je terminerai par remercier toutes les personnes qui me lisent, qui me croient, qui écrivent à leur tour, toutes celles qui prennent des risques chaque jour, qui n’en peuvent plus d’être harcelé mais qui ne lâchent rien, merci à celles qui ne disent rien pour le moment mais qui casseront des portes prochainement merci aux adolescents d’aujourd’hui qui font ce qu’on n’arrivait pas à faire avant, qui ne laissent plus rien passer.
Merci pour celles qui ont été là quand c’était pas évident, et qui ont continué à l’être quand ça l’était.
Merci à toutes celles qui ouvert la voie, toutes celles qui ont fait le taff avant qu’on arrive.
Merci à vous d’être là ce soir.
BIO
S'identifiant comme une écrivaine musulmane, féministe et queer, Fatima Daas apparait comme la nouvelle voix de sa génération. Elle grandit dans la banlieue parisienne à majorité musulmane de Clichy-sous-Bois, avec ses parents et ses sœurs d'origine algérienne. Elle est la seule à être née en France. Au lycée, elle se rebelle et revendique le droit d'exprimer ses idées en rédigeant ses premiers textes. Son talent littéraire ne passe pas inaperçu, et elle entame des études de littérature. Son premier roman, La Petite Dernière, est publié en 2020 avant d’être traduit en neuf langues.
Cette conférence a été cofinancé par le programme Europe créative de l'Union européenne